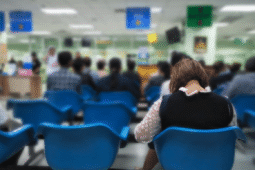Saint-Colomban: 175 ans et en pleine vie!
Par Rédaction
Chaque mois Accès vous fait découvrir une municipalité qui est un véritable «trésor caché des Laurentides», à travers son Histoire et les enjeux qui l’attendent… Cette semaine: Saint-Colomban. Connaissant l’une des plus fortes croissance démographiques au Québec, cette municipalité se distingue à plusieurs égards.
Accès met cette semaine en lumière l’Histoire de ce lieu formidable, qui célèbre cette année ses 175 d’existence, au potentiel remarquable dans notre région.
Ardnaglass, Irlande, 6 septembre 1846, Michael Rush et son épouse Mary Barrett subissent l’effroyable famine engendrer par la maladie de la pomme de terre et qui causera des millions de morts en Irlande.
Désespérés ils écrivent au père de Mary, Thomas Barrett à Saint-Colomban, où une colonie d’émigrants irlandais si est installée depuis une vingtaine d’années: «Ici règne une pauvreté indescriptible, le gouvernement donne un petit peu d’argent pour empêcher que les gens aillent dans les champs tuer le bétail. Maintenant chers parents, pitié pour notre condition précaire, et ne nous laissez pas parmi ceux qui seront compter pour morts de faim et si vous pouviez nous garder jusqu’à ce que nous puissions gagner à n’importe quel travail que vous pourriez nous trouver, nous serions très heureux de le faire.»
«Tout ce que l’on peut vous dire c’est que le fléau de Dieu est tombé sur l’Irlande, lui enlevant ses patates, dernier soutien pour le peuple. Alors chers père et mère, si vous ne tentez pas de nous en sortir, la première chose que vous apprendrez de nos amis sera que moi et ma petite famille figurerons parmi les milliers qui seront disparus morts de faim. Ceux qui ont de l’avoine ou du blé ont peut-être une chance, disant qu’ils mourront avant d’en donner une partie pour payer le loyer.»
Cette lettre de désespoir ne fut pas sans suite car nous retrouvons Michael Rush et son épouse Mary Barrett à Saint-Colomban quelques années plus tard. Il y eut ainsi quelques familles qui accueillirent des parents, mais les autorités du temps n’appuyèrent pas le projet du député d’Argenteuil J.C Forbes de les recevoir en grand nombre car cela aurait créer un précédent et des choix déchirants devant la difficulté de les accueillir. Mais pourquoi, et comment, ces Irlandais s’étaient-ils établis dans ce qui deviendra Saint-Colomban en 1835?
Fuyant l’Irlande où les guerres napoléoniennes dont le blocus avait fait chuter les prix des produits et plus tard les grandes périodes de famines, causés par la maladie de la pomme de terre, les premières vagues d’Irlandais s’installèrent dans la ville de Québec pour ceux qui avaient survécu au choléra et à la dysenterie après un séjour de quarantaine à la Grosse île.
D’autres groupes d’Irlandais s’installèrent à Montréal particulièrement dans le quartier de la Pointe-Saint-Charles.
C’est là que sous la gouverne du père Richard Jackson, de concert avec les sulpiciens qui détenaient la seigneurie des Deux-Montagnes que l’on favorisera le premier établissement des Irlandais sur des concessions de la seigneurie dans son extension vers le nord ce qui deviendra Saint-Colomban.
Le premier censitaire ne fut pas un Irlandais, mais plutôt un meunier de Belle-Rivière Hilaire Joubert qui reçut les deux premières concessions de la région le 2 mars 1819.
Par la suite s’établirent, comme en témoigne le recensement de la population de 1825, les Hughes Reilley, James Murphy, en 1821, James Cowley, William McCormick, Patrick McGoey, Michael Fahey, Alexander McNabb, en 1822, et tous les autres tels John Snowdon, John McGee Michael Ryan, il y a alors 253 personnes en 1825 sur le territoire de Saint-Colomban presque tous irlandais quelques écossais et des québécois de souche française. En 1831, leur nombre justifie la construction d’une chapelle sous le patronage de Saint Colomban, un moine d’origine irlandaise
Les Irlandais de Saint-Colomban sont catholiques, parlent anglais, peut être encore un peu gaélique, et se voit confronter à des adversaires de taille pour s‘établir: la pauvreté du sol et le climat rigoureux.
Ce sol a ceci de particulier qu’il est sablonneux et si caractéristique, que les experts gouvernementaux le qualifient de «sol Saint-Colomban» et par extension à tout autre sol ingrat de ce genre dans la province. Exilés d’une terre ingrate, affamés, les nouveaux arrivants durent s’adapter à ces nouveaux ennemis de leur condition sociale, en ce sens la devise adoptée par la ville: «Patrie et exil», écrite en style oncial, décrit bien le sens identitaire irlandais dans sa force et sa précarité.
Mais comment se fait-il qu’il n’y ait presque plus d’Irlandais à Saint-Colomban de nos jours?
Les irlandais étaient-ils moins courageux que les colons canadiens français qui s’établirent à Saint-Jérôme où les terres n’étaient pas plus fertiles? On aurait pu penser que la désertion et le dépeuplement de Saint-Colomban par les irlandais aurait été logiquement le fait du sol pauvre et de l’économie stagnante, malgré quelques beaux succès comme la fabrication de la potasse et de l’industrie forestière, les moulins seigneuriaux ainsi que la présence d’artisans, mais après une conversation avec l’ethnologue Claude Bourguignon les faits s’avèrent plus complexes, il est vrai que la pauvreté du sol et son rendement incertain ont chassé un nombre d’irlandais en quête de nouveaux espoirs,surtout de l’attrait de la vie urbaine,mais une raison plus particulière: le célibat, en effet les jeunes irlandaises qui se rendaient à Montréal pour y travailler comme domestiques souvent y rencontraient un amoureux ,s’y mariaient et s’établissaient en ville, idem pour les célibataires masculins qui se rendaient à Bytown
(Ottawa) pour le travail de bûcherons et qui dans des villes plus grandes avaient plus de chances de trouver à s’y marier quittant ainsi Saint-Colomban qui devint au fil du temps, après quelques générations en décroissance à partir de la décennie de 1860, passant d’une population de 896 à 291 en 1911.
De nos jours il n’y a presque plus d’Irlandais à Saint-Colomban, tout au plus une cinquantaine.
À la même période des immigrés européens, surtout des Polonais, Ukrainiens et Russes s’établirent à Saint-Colomban. Plus tard, d’une agglomération de pionniers, Saint-Colomban devint un endroit de villégiature fort prisé, puis ces habitations secondaires furent transformées en développements domiciliaires et de nos jours une ville dite de banlieue émerge où une démographie exponentielle a produit une population de plus de 12 000 personnes dont la moyenne d’âge est de 35 ans avec un si grand nombre de jeunes enfants qu’il y a trois écoles primaires et qu’une quatrième est en voie d’établissement. Une belle réalisation pour ces jeunes est le terrain de soccer de niveau provincial où si déroulent de nombreux tournois de haut niveau. Toujours côté sport, la pratique de l’équitation est des plus prisés dans la région ainsi que la pratique du golf au terrain Bonniebrook. Les employés municipaux peinent à suivre la cadence tellement les besoins et le services se multiplient mais il semble qu’il y ait un projet mixte de centre culturel et commercial qui sera érigé coin montée de l’église et Côte Saint-Paul. Il devrait accueillir une plus grande bibliothèque et un centre d’exposition peut être y aura-t-il une salle consacrée à la mémoire des premiers irlandais?
Lucie Jubinville bibliothécaire depuis quelque 27 ans à la municipalité, souligne que la culture se porte bien à Saint-Colomban qu’elle a bien hâte d’occuper ses nouveaux locaux avec toutes les possibilités qu’elle entrevoit.
La région semble un endroit propice pour les sculpteurs sur bois qui y sont fort nombreux la nature environnante, les lacs ,ne seraient pas étrangers à cette présence et lors d’une visite à l’Hôtel-de-Ville nous avons remarquer qu’il semble y avoir une ébauche d’un mariage art et espace, alors que l’administration municipale lors des journées de la culture fait l’achat annuellement d’une oeuvre d’un artiste de la municipalité pour en faire bénéficier les citoyens et les sensibiliser à la beauté de l’art.
Des photographies d’époque y sont aussi très bien présentées. Nous avons aussi rencontré Béatrice Daoust, présidente de la fabrique de l’église de Saint-Colomban, église érigée en 1861, elle nous a présenté la clé originale de la porte d’entrée et souligner la préservation du premier autel, vous pouvez le voir en entrant, il est sur la gauche. L’on accueillera bientôt en personne… le retour de Saint Colomban, (sa statue…) 1835! car ce grand voyageur… est présentement à l’exposition «Irlandais O’Québec» au musée McCord.
Le lancement des fêtes du 175e anniversaire aura lieu le 14 mars 2010 quelques jours avant la Saint Patrick, madame Daoust nous a présenté les magnifiques verreries crées pour remplacer les précédentes trop abîmées pour une restauration et c’est sous la maîtrise d’oeuvre de Marie-Marthe Gagnon, artiste en arts visuels, qui avec l’aide de nombreux bénévoles, et le parrainage de mécènes paroissiaux que put être réalisée ces magnifiques vitraux, il y en a vingt-quatre, à voir pour la beauté et la démarche intellectuelle.
Lors de notre passage il nous fut à même d’apprécier l’humour de l’officiant de la messe, le prêtre desservant l’abbé Claude Massicotte qui entendant une de ses paroissiennes s’adressant aux fidèles assistant à la messe et décrivant l’album souvenir des familles de Saint-Colomban, ajouta, narquois: «J’aimerais avoir ma photographie en première page….» Le 1er juillet, toujours dans le cadre du 175ième, il y aura les retrouvailles des descendants des irlandais autour de l’événement de la grande tablée. Retrouvons nos pionniers irlandais car leurs descendants ne les ont pas oubliés et bien qu’essaimés aux quatre coins de l’Amérique, cette diaspora revient régulièrement à Saint-Colomban y visiter le cimetière, honorer l’ancêtre, chercher avec l’aide des personnes ressources, dont monsieur Bourguignon, une maison, un terrain, un lieu de mémoire, mais il y a plus, il y a quelques années un groupe de visiteurs irlandais constatèrent que des pierres tombales avaient été empilées sans cérémonie les unes sur les autres dans des buissons derrière l’église, c’est alors que naquit le projet de restauration du cimetière ainsi que de la création d’un répertoire virtuel pour classer les pierres endommagées, les pierres existantes et répertorier les individus enterrés sans jamais avoir eu de pierre tombale ou que celles-ci demeurent introuvables. Parions qu’avec l’aide de l’administration municipale ce projet en développement trouvera son aboutissement lors des fêtes commémorant le 175e anniversaire (1835-2010) de la ville de Saint-Colomban: «Que mon tombeau demeure sans inscription et ma mémoire dans l’oubli, jusqu’à ce que d’autres temps et d’autres hommes permettent que l’on me rende justice.»
Robert Emmett (1778-1803), héros de la lutte irlandaise contre l’oppression anglaise.
Accusé de haute trahison et exécuté par le pouvoir britannique.
Peut être choisiront-ils plutôt d’imiter la pensée de Saint Colomban: «Ne soyez pas les hommes d’un moment.»