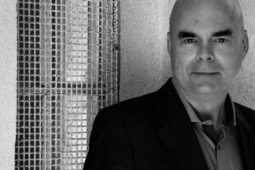Clothaire Rapaille et la prison de Montréal
Par Rédaction
Dans les années 1800-1835, une des premières prisons à Montréal était située, là où est la Place Jacques-Cartier de nos jours, soit sur le côté ouest de la colonne Nelson, coin Notre-Dame.
Les crimes étaient similaires à ceux de notre époque, mais les sentences rendues par les juges et la discipline des prisons, se différenciaient par des châtiments plutôt cruels.
De nos jours, maints hurluberlus, qui sévissent aux nouvelles télévisées, et dans la promiscuité des lignes ouvertes, réclament des peines plus sévères, avec des condamnations lourdes, et même des sévices corporels, du moins si on accepte de prendre leurs opinions au pied de la lettre.
À ces bourreaux modernes qui croient que la sentence est un remède, voyons comment il en était auparavant. Les juges condamnaient à des peines d’emprisonnement qui très souvent étaient assorties de travaux forcés, mais il y avait possibilité pour bonne conduite d’alléger sa peine avec ce qui de nos jours serait considéré comme une libération conditionnelle, il s’agissait plutôt d’un cautionnement pour garder la paix.
Parmi les autres châtiments qu’un criminel pouvait recevoir, il y avait la marque au fer rouge, le pilori, le fouet et la pendaison. Si un prisonnier causait des ennuis à ses gardiens ou aux autres prisonniers, il pouvait recevoir différentes punitions à l’intérieur de la prison selon la gravité de l’offense…
Dormir sans lit: «une cellule où un homme pouvait à peine se retourner quand il était couché», être nourri au pain et à l’eau pour une période n’excédant pas 5 jours, isolé dans une cellule obscure, ou enchaîné, telles étaient les punitions courantes.
Voyons maintenant un exemple d’une sentence rendue pour nous aider à comprendre la mentalité propre à cette époque.
Le 24 août 1826, un certain J. Bouchard, est reconnu coupable de meurtre, et condamné à être pendu, le juge commue toutefois sa sentence en une détention précise de quelques années, avec l’obligation d’effectuer des travaux forcés, mais aussi de subir le châtiment du marquage au fer rouge à la main.
En quoi consistait ce châtiment? On conduisait l’individu à un endroit précis de la prison où la population pouvait le voir subir sa peine, on l’immobilisait alors tout en plaçant sa main, paume tournée vers le haut, puis le bourreau approchait un fer rougi, sorti du feu, et lui disait qu’il allait appliquer le fer rouge à l’intérieur de sa main tant qu’il n’aurait pas prononcé la phrase: «Vive le Roi», à trois reprises, les trois phrases répétées, il arrêterait le supplice.
Pour un prisonnier anglophone, celui-ci devait répéter trois fois: «God save the King», ce qui était plus long, pour une fois que la langue française l’emportait sur l’anglaise, nous le signalons…
Traitement, il va de soi inhumain, dont l’individu gardait l’empreinte effroyable sa vie durant.
Le pilori consistait à construire un assemblage de bois avec des ouvertures pour la tête et les mains, souvent surélevé, le criminel s’y voyait installer dans une position des plus inconfortables presque étranglé et soumis à l’indignation publique, à l’infamie.
Lorsque vous fréquenterez la Place Jacques-Cartier, notez que le pilori était placé au pied de la statue de Nelson face au fleuve, le bourreau, fouet à la main, faisait tourner ledit pilori en un cercle complet alors que la foule rendait justice… en lançant des immondices, des excréments et en insultant le supplicié, car il s’agissait bien d’un supplice, dont celui qui le subissait gardait des séquelles physiques importantes, selon la durée du châtiment, qui pouvait varier de quelques heures, à quelques jours.
Quant au fouet, «le chat aux neuf queues», on appliquait cette peine à ceux qui battaient leurs épouses, aux voleurs de grands chemins et aux criminels violents.
Le nombre de coups de fouet était invariable, à savoir trente-neuf, que l’on infligeait au criminel lié sur un poteau ou un canon. Ce nombre de trente-neuf, est présent dans l’histoire des juifs, alors que l’apôtre Paul, relatant les sévices reçus pour la cause de son maître dans son 2e épître aux Corinthiens, verset 24, mentionne «que les Juifs lui infligèrent à cinq reprises, quarante coups de fouet, moins un, nombre ordonné par la loi de Moïse», déjà les accommodements raisonnables… La pendaison que l’on infligeait de moins en moins fréquemment, la réservant pour les meurtriers ou ceux commettant le crime de haute trahison. Elle avait été utilisée fréquemment pour des crimes qui nous semblent mineurs tel le vol de cheval, ce qui pourtant ne dissuadait en rien les voleurs, car nous relevons beaucoup de pendaisons pour un tel genre de crime.
Doit-on en conclure, que les peines de prison, fussent-elles lourdes et les châtiments cruels, n’ayant pas enrayé le crime, qu’il faille absoudre crimes et criminels? Non bien sûr.
Toutefois, je réserverais une visite guidée de la Place Jacques Cartier pour un ami du Québec: le gourou Clothaire Rapaille, venu promouvoir la «marque» de la ville de Québec, nous pourrions lui remettre notre «marque» particulière, une fleur de lys au fer rougi à l’intérieur de la main, puis quelques heures face au fleuve, dans un confortable pilori… il comprendrait alors en quoi consiste vraiment le sado-masochisme…