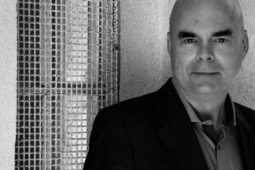Vin, cognac et térébenthine, à votre santé
Par Rédaction
La société contemporaine a une obsession pour la santé qui me semble maladive…
Produits naturels,médecine douce, régimes, pilâtes, esthétisme, chirurgie, cholestérol, poids santé, maison santé, animal santé, journaliste santé… Suffit, trop de santé nuit à la santé!
Voyons comment au siècle précédent on se soignait, et comment nous pouvons en tirer des leçons de nos jours.
Dans les années 1900-1930 il n’y a pas d’assurance-maladie et s’il y a une hospitalisation c’est catastrophique, c’est la hantise des familles alors que la société vit en même temps la pire crise économique que fût celle du krach de 1929.
Alors les gens se soignent eux-mêmes, considérant que la maladie était l’expression de la volonté de la providence, ils étaient fatalistes. Malaises, maux, maladies et épidémies étaient monnaie courante dans cette société où l’état d’insalubrité est le quotidien, que le mot pollution n’était pas à la mode, pas plus qu’environnement, que les nombreuses inondations dues aux nombre d’égouts insuffisants, les industries polluantes, les services de santé de la ville de Montréal déficients et que même l’hôpital du Sacré-Coeur, qualifié d’hôpital pour les incurables, jetait ses déchets dans le ruisseau Raimbault qui se déversait dans la rivière des Prairies. Ajouter à cela le lait rempli de microbes, la tuberculose, les gens qui chiquent et qui utilisent des crachoirs à cette fin que l’on retrouve partout et nous voilà fort éloignés des gens que l’on croise quotidiennement de nos jours avec la petite bouteille d’eau à la main et la salade vitamine du midi…
Les témoins de cette période qui nous ont laissé une histoire orale recueillie par des chercheurs décrivent comment leurs parents s’y prenaient pour les soigner.
Ainsi Bernadette G, pour donner de l’appétit à ses enfants, leur servait-elle du vin ferré: elle achetait une livre de grands clous neufs, les ébouillantait et les mettait dans une bouteille de vin, elle laissait fermenter puis en versait au travers d’un bas de coton et en servait un verre à ses enfants avant le repas… Antonia L, raconte que pour soulager un rhume d’estomac «ma mère préparait une cuillère à soupe de mélasse et mettait dix gouttes de térébenthine dans la mélasse et donnait cela à ses enfants, la térébenthine était aussi bonne pour chasser les vers.» «Une fois une roche m’était tombée sur la tête. Ç’a m’a fait une entaille qui saignait beaucoup. Ma mère l’a lavée et soignée avec une feuille de tabac…»
Bella G, centenaire, elle a exactement cent deux ans au moment de l’entrevue, offre un peu de brandy au chercheur ,car elle n’a plus de cognac… qu’elle prend toujours le matin à onze heures, comme tonique, une cuillérée avec un peu de lait.
Madame Bella pour fuir la crise, vint habiter à «Saint-Sauveur-des-Montagnes…» chez son frère célibataire, et son mari ouvrit une échoppe de cordonnerie, ce qui leur permit de traverser la crise tant bien que mal. Il y a deux traits culturels propres aux Canadiens-Français qui les ont aidés à passer l’épreuve de cette crise et accepter la maladie: l’esprit de la fête et la solidarité familiale.
On peut le constater lorsqu’on visionne le documentaire: «La turlutte des années dures.»
La chanson est alors sur toutes les lèvres, on va au cinéma et on joue aux cartes le 500, les coeurs, cache-cache, le rummy, on fête Noël, bref, la misère n’est pas une excuse, n’est pas une tare, il y a une acceptation et même un bonheur dans le malheur. Que constatons- nous, presque un siècle plus tard, alors que même les pauvres ont le confort, le crédit, que l’assurance-santé et la médecine moderne préviennent, soignent, guérissent, le tout gratuitement? Il y a insatisfaction générale, curieux paradoxe d’une société malade de son embonpoint avec pour résultat une détresse psychologique inquiétante, qui n’avait pas son équivalent au siècle précédent alors que les gens étaient selon l’expression populaire: «durs à leur corps», acceptant leur sort chanson aux lèvres…
Qui chante maintenant? On ne chante plus, nous sommes au siècle de la communication pour ne rien dire, ou pour tout dire, bref à l‘insignifiance technologique. Il est onze heures, je termine cet article…
Pour en savoir plus: «Montréal de vive mémoire 1900-1939» de Marcelle Brisson et Suzanne Côté-Gauthier,chez Triptyque.