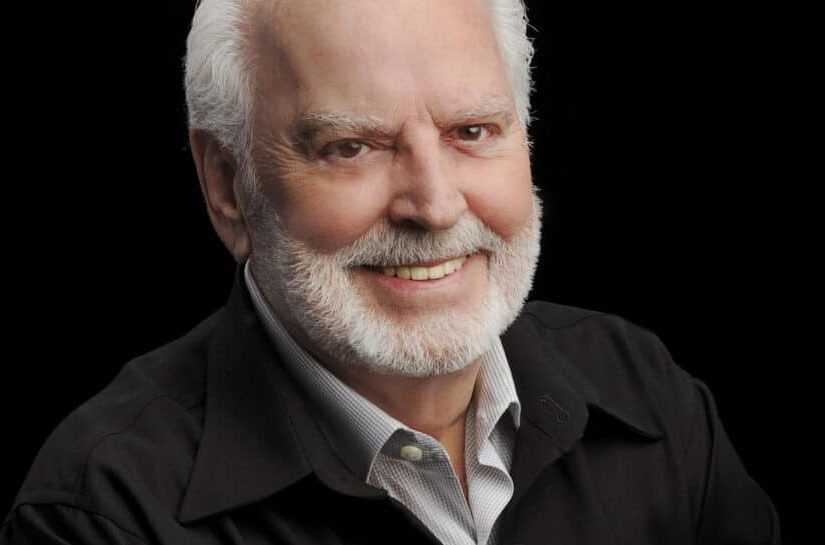André Perry et la musique, inséparables
Avez-vous déjà écouté Jaune de Jean-Pierre Ferland? Ou Lindberg de Robert Charlebois? Peut-être Moving Pictures de Rush? Sûrement Saturday Night Fever des Bee Gees? Alors vous avez déjà entendu le travail d’André Perry. Il est omniprésent dans la musique tant québécoise que mondiale. Rencontre avec une légende.
André Perry nous accueille chez lui, à Saint-Sauveur. Lorsqu’on arrive, il est au téléphone avec son associé. « Oui, j’écoute ça dès que je peux. » À 85 ans, il continue d’enregistrer de la musique, comme il l’a fait toute sa vie. Durant sa longue carrière, il a enregistré tous les grands noms de la musique et a participé à un nombre incalculable d’albums. « Peut-être deux ou trois cents, je dirais. »
Laisser sa marque
André Perry est d’abord musicien de jazz. Au début des années 1960, il commence par enregistrer avec des amis, dans son sous-sol. « Après ça à Brossard, j’ai bâti mon premier studio qui se voulait professionnel. […] Mon premier client était un musicien country et western, québécois. Il a trouvé ça tellement bon que ça s’est parlé. J’ai fini comme le king du western », raconte-il en riant.

Dans les années 1960, M. Perry se fait rapidement une réputation. Durant l’Expo 67, on lui confie la conception sonore de quatre pavillons, dont ceux du Canada et du Québec. « Je travaillais aussi comme musicien en plus, au pavillon du Québec le soir. » Il fera aussi les cérémonies d’ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de Montréal, en 1976.
Durant le Bed-In for Peace de John Lennon à Montréal, en 1969, c’est lui qui enregistre Give Peace a Chance. « J’ai vraiment sauvé la donne. C’était inutilisable. Acoustiquement, c’était affreux. » Il doit remixer l’enregistrement dans son studio, et invite Charlebois, Mouffe et d’autres artistes québécois pour chanter. « Le « thump, thump » que tu entends, c’est mon bac à ordures en caoutchouc », confie-t-il avec le sourire.
Entre autres, il enregistre Lindberg (1968) de Robert Charlebois et Louise Forestier. Et aussi Jaune (1970) de Jean-Pierre Ferland. Ces deux albums avant-gardistes marquent un point tournant dans la musique québécoise et ce qu’elle peut être. « Jaune, c’est marquant. Et c’est marquant pour moi aussi, dans ma carrière. Jaune garde une grande importance pour moi, et je l’écoute encore régulièrement, au moins une fois par mois. J’ai besoin de me mettre à jour, au niveau de l’importance de ces moments-là. »



Le Studio
À 30 ans, il considère être déjà arrivé au bout de cette première aventure. « Écoute, j’avais fait toutes les grandes vedettes québécoises. C’était tous des amis. Mais j’étais trop jeune. Je sentais qu’il y avait un plus gros voyage à faire. »
Il prend donc une année sabbatique. Parfaitement bilingue, et avec une « soif de l’international », il part. « Cette année sabbatique-là, je l’ai faite en voyageant partout à travers le monde, pour aller voir tous les autres studios qui étaient célèbres. Et à chaque fois que j’y allais, comme un petit Québécois, je me disais : « Oui mais attend. Je peux faire mieux que ça! » »

À son retour, en 1974, il met sur pied Le Studio à Morin-Heights. « Le besoin était de bâtir le studio pour moi », souligne-t-il. À l’époque, chaque studio a un son et une culture qui lui sont propres, et que les artistes recherchent. Mais pas Le Studio d’André Perry. « Moi, je défiais ça. […] Je disais qu’un studio, c’est un instrument de musique aussi. »
Ce n’est pas long avant que le nom de Perry se mette à circuler parmi les artistes.
« J’avais fait Lewis Furey, le morceau Lewis is Crazy. Et son manager était aussi celui de Cat Stevens. Il écoute ce qu’on avait fait avec Lewis et il dit : « Oh, ça sonne bien. » Le manager dit : « Oui, c’est une espèce de fou au Québec, au Canada, en quelque part dans le bois. » Je reçois un appel de Cat Stevens qui me dit qu’il réserve quatre jours. Il est resté deux mois. Il a fait quatre disques et on est devenus des grands, grands copains. Il a même écrit une chanson pour Yaël et moi, Two Fine People. Et ç’a commencé comme ça. »
Dans Le Studio, André Perry accueillera les plus grands noms de la musique américaine et anglaise. « J’ai fait venir les gens au Québec, à la place de moi, m’immigrer ailleurs », dit-il fièrement.
Contrairement aux autres studios où on payait à l’heure, les artistes louaient Le Studio pour plusieurs jours, voire quelques mois. « Ils étaient chez eux. » Le décor champêtre de Morin-Heights et l’accueil généreux des Québécois servent aussi à séduire les musiciens. « Il n’y avait pas d’endroit comme ici, où Sting allait faire du ski, où Cat Stevens se promenait dans le village », raconte-il.
La fin d’une époque
En 1988, M. Perry vend son studio. L’industrie de la musique, il le sait, est sur le point de changer. « Saturday Night Fever avait vendu à l’époque 30 millions de disques. Et ils avaient découvert qu’il y avait eu au moins 36 millions de disques copiés. Et on se recule il y a 40 ans! […] Aujourd’hui, la musique est gratuite. Les gens ne paient plus. Ça coûte dix piasses pour n’importe qui. Et tu as juste deux ou trois gros producteurs qui font toute l’argent, et les artistes ne sont pas payés. Alors nous, on l’avait vu avant. »
L’arrivée du numérique, qui remplacera les formats analogues comme le vinyle, réduit aussi énormément la qualité du son. « On n’a pas de profondeur de champ. La musique populaire est très compressée. En conséquence, elle est sur un seul plan », explique-t-il. Toute la chaleur et la rondeur de l’analogue disparaît. Et la deuxième harmonique, si agréable à l’oreille, est perdue.
C’est pourquoi, après une autre année sabbatique, André Perry se lance dans la musique haute définition, avec sa femme Yaël Brandeis et son associé René Laflamme. « 2xHD, qui est notre label, est absolument unique dans le monde. » Il y fusionne le meilleur de l’analogue et du numérique, et utilise des formats qui préservent toute la richesse, les nuances et la chaleur de la musique, comme le DXD. « Le DXD, c’est 1 200 000 échantillons par seconde. Un CD, c’est 44 000 », illustre-t-il.
André Perry nous en fait écouter. L’expérience est… surréelle. C’est la différence entre écouter de la musique et la ressentir. En écoutant un trio de jazz, on a l’impression qu’il joue juste là, devant nous. Le saxophone est si clair, si chaleureux, si vibrant qu’on pourrait presque le toucher. « Plus on arrive au naturel, plus on arrive au vrai, plus on arrive à l’émotion, et plus on arrive au coeur », explique-t-il. De retour chez moi, la musique de Spotify me semblera plate, sans relief, pâle. Vide, surtout.
André Perry et son label sont « encore les meilleurs au monde », mais dans un cercle plus intime d’audiophiles.
Le bonheur plutôt que les honneurs
Dans son bureau, plusieurs prix, disques d’or et distinctions entourent André Perry. Mais il en parle avec nonchalance, détachement. « Il y en avait à peu près 200 à un certain moment. Quand j’ai vendu Le Studio, je ne voulais pas essayer de partir avec les cadres. Je ne trouvais pas ça correct. J’ai seulement gardé l’essentiel, ceux qui me sont le plus cher. »
« Je suis vraiment comme un enfant. Je ne sens pas mon âge, évidemment. C’est le pur bonheur, entouré de la musique. »
Parmi eux, je remarque Saturday Night Fever des Bee Gees et Moving Pictures de Rush. Il me montre son doctorat honoris causa de l’Université Laval et son Ordre du Canada. « J’ai un grand disque avec Vladimir Vissotsky, qui était le Dylan de la Russie durant la révolution », ajoute-il. Derrière lui, un unique Félix m’intrigue. « Ça, oui, c’est pour l’ensemble de ma carrière. » Il faut savoir que c’est lui, avec quelques autres, qui a créé le gala de l’ADISQ, pour faire rayonner la musique québécoise.

C’est que, pour André Perry, les honneurs sont secondaires. Ils sont appréciés, mais ils sont loin d’être l’essentiel. Sa passion se nourrit de bien d’autres choses.
« Ce qui importe, c’est de continuer à créer, à poursuivre ça : le bonheur que tu as. Et le bonheur, ce n’est pas la gloire ou l’argent. Le bonheur, c’est le geste que tu poses quand tu crées une œuvre, ou quand tu travailles avec des gens. Et moi, je me suis toujours entouré des gens qui étaient meilleurs que moi, aussi. »
À 85 ans, c’est toujours la musique qui le nourrit. « La musique te donne la longévité et une paix. Elle en est la source la plus extraordinaire de tous les arts. Et moi, je n’ai jamais pu vivre sans ça. Alors c’est la passion. »
Il doit aussi beaucoup à sa femme, tient-il à souligner. Ils sont mariés depuis 57 ans. « J’ai eu l’opportunité d’avoir Yaël avec moi, qui m’a aidé beaucoup. Je n’aurais pas eu cette carrière sans ma femme. Elle a vu à plein de choses que moi, je ne voulais pas me mêler. L’administration du Studio, c’était elle. Et on est toujours en amour comme des enfants. Écoute, je suis gâté. Ne te demande pas pourquoi je suis heureux. »